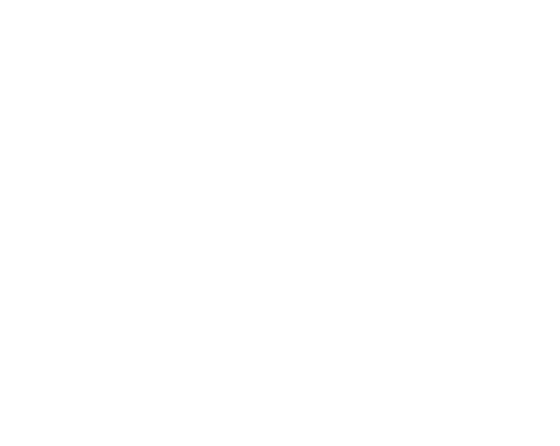Tics de langage : ces petits mots qui polluent notre parole
« À fond », « Du coup », « Tu vois », « Genre », « Grave », « En fait », « Carrément » ! Ces petits mots ponctuent nos échanges. Définis par le terme « tic de langage », ils nous agacent dans la bouche des autres, mais la nôtre n’arrive pas à s’en défaire. Comment les définit-on ? Quels sont les plus courants ? Comment les éviter lors d’une prestation orale ? Zoom sur ces petits mots du quotidien qui se glissent dans nos conversations, souvent à nos dépens.
Qu’est-ce qu’un tic de langage ?
Le « tic de langage » est une métaphore, par extension du terme « tic ». Il s’applique à des mots ou des expressions qui semblent incontrôlées. Lorsqu’ils sont prononcés par un orateur, ils peuvent jouer un rôle dans le discours sous la forme de connecteurs, de mots béquilles ou d’onomatopées.
L’usage abusif des connecteurs
Les connecteurs permettent des relations sémantiques au niveau local entre deux propositions juxtaposées et reliées, et au niveau global dans la structuration du discours. Ils contribuent ainsi à homogénéiser les éléments qu’ils relient. Les liens exprimés au moyen de connecteurs contribuent à la cohérence et à la cohésion du discours. Ils constituent donc un puissant moyen d’intégration d’informations disparates et d’enchainement du propos.
« Les tics de langage servent à maintenir le contact entre la personne qui parle et la ou les personnes qui écoutent ». Jérôme Jacquin
Certains connecteurs expriment la conséquence. À l’oral, des expressions comme « du coup » ou « donc » seront souvent entendues à cet effet. Or, comme le précise l’Académie française, l’emploi de « du coup » est souvent inexact, et peu élégant par ailleurs. Il est possible d’utiliser d’autres formules comme : « en conséquence », « de ce fait », « donc », « par conséquent », etc. La conjonction de coordination « donc », même si les grammairiens sont divisés sur la question de sa nature grammaticale, a tendance à être utilisée malencontreusement en début de phrase pour introduire le propos. « J’entame mon propos… », « Débutons », seront des expressions plus appropriées dans ce cas.
Les mots béquilles dans un discours
Un tic de langage peut aussi être un mot béquille ou « tuteur » : il sert à combler le discours par des mots de remplissage. C’est le cas de « et voilà », que l’on entend parfois à la fin d’une démonstration. Agathe Tupula Kabola, orthophoniste au Canada, souligne malgré tout l’utilité psychologique et sociale de ces mots béquilles, lors de conversations, entre autres pour mieux faire passer notre message.
« Utiliser des pauses verbales peut servir à plusieurs choses, notamment à atténuer les désaccords ou les critiques en les rendant un peu plus polies pour ne pas blesser les sentiments de la personne à qui l’on parle. Par exemple : “Hum, ce n’est pas mon préféré” ». Agathe Tupula Kabola

L’orthophoniste évoque aussi l’universalité des tics de langage, en citant les expressions anglaises look et anyway, ou les aizuchi en japonais : hai (はい, oui), ee (ええ, oui), sou desu ne (そうですね, je vois), ou encore naruhodo (なるほど, je comprends). Ces interjections sont utilisées pour rythmer la conversation et éviter les silences qui pourraient être interprétés comme un manque d’intérêt ou de compréhension.
Les onomatopées qui marquent l’hésitation
Les onomatopées, telles « hein », ou « euh », bredouillées dans un discours pour combler un vide, peuvent être perçues comme un manque d’assurance et de préparation. Si les idées ne s’enchainent pas de façon fluide, les sons émis donnent à l’orateur l’impression d’une certaine contenance et le rassurent. En revanche, pour le public, ces tics de langage perturbent la compréhension et le message porté par le locuteur.
Chez les enfants, le « euh » sert aussi à combler les silences pendant une réflexion sur les propos à venir. La durée offerte par l’expression de l’hésitation révèle un manque de confiance en soi. Tic de langage par excellence, il provient d’une onomatopée et apparaît pour la première fois à l’écrit en 1662 comme interjection exprimant la contrariété et l’irritation d’Arnolphe chez Molière, dans L’École des femmes (acte II, scène 2).
Au-delà d’un manque d’assurance ou de préparation, « euh » exprime l’incertitude ou l’embarras. Les émotions transmises par le locuteur à son assistance peuvent parfois jouer un rôle précieux dans la déclamation d’un discours. Plus largement, l’utilisation de l’interjection « hein » s’emploie pour attirer l’attention ou susciter l’approbation.
Quels sont les tics de langage les plus employés lors de nos prises de parole ?
Certains linguistes placent ces petits mots du quotidien dans la catégorie « fourre-tout ». Ces expressions sont généralement employées pour condamner l’usage d’un néologisme ou d’une expression à la mode.
Les tics d’approbation
De nombreuses expressions sont employées inopinément pour signifier l’approbation. « C’est clair » signifie, dans le langage familier, que les explications sont limpides, qu’il n’y a pas besoin d’en dire davantage pour comprendre. Pourtant, cette locution interjective est utilisée à mauvais escient, pour signifier notre accord avec l’interlocuteur. « Ce joueur a vraiment été mauvais ! C’est clair ! » : il serait préférable de dire, dans un langage plus soutenu, que l’on est d’accord, que cela ne peut faire l’objet d’aucune contestation.
L’adverbe « carrément » est une équivalence de « c’est clair ». Signifiant « de façon nette, sans détour », il est souvent (mal) utilisé en lieu et place de « tout à fait ». « Je l’ai trouvé bon dans le rôle du méchant. — Tout à fait ! »

Des expressions comme « ça marche » et « on fait comme ça » servent à marquer notre adhésion aux propos d’autrui. Il vaut mieux privilégier : « c’est entendu », « je suis d’accord » ou « je m’en occupe… », moins familières.
Bien entendu, nous pouvons dire et redire qu’il n’y a pas de souci, mais veillons à ne pas en abuser.
Les tics d’enchainement
Outre « du coup » cité plus haut, le terme « en fait » compte aussi parmi les tics de langage souvent utilisés pour enchainer le propos. C’est une locution adverbiale signifiant : « réellement », « vraiment » ou « contrairement aux apparences ». L’Académie française rappelle qu’« en fait » est employé à tort à la place de la conjonction de coordination « mais ». Il convient d’éviter cette confusion et de conserver à la locution « en fait » son sens plein.
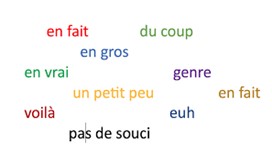
L’adverbe « enfin » sert à ponctuer nos prises de parole : « et… enfin, vous voyez ce que je veux dire ». Il signifie « au terme d’une longue attente ou en dernier lieu ». Mieux vaut l’éviter. En effet, cette pratique linguistique est très fréquente à l’oral, dans une communication verbale, dite conversation quotidienne. Bien que ce tic de langage soit perçu comme un mot-outil servant à l’enchainement du propos pour le locuteur, il est qualifié de parasite pour l’auditoire.
Les tics d’explication
D’autres expressions assimilées à des tics de langage sont prononcées au cours de discours explicatifs. L’expression « Tu vois » sert à s’assurer de la compréhension ou à maintenir l’attention. C’est un tic de langage qui revient à dire : « vous me suivez ? ».
« De base, à la base » est une expression fourre-tout qui peut signifier : « au départ », « au début », « au commencement », « d’abord », « en premier lieu »… Ces derniers termes sont à privilégier, selon le cas.
« C’est pas faux » est une réplique devenue presque mythique grâce à la série Kaamelott, Perceval, l’un des chevaliers de la Table ronde, utilise fréquemment l’expression quand il ne comprend pas ce qu’on lui dit, pensant que cela camoufle son incompréhension. Très souvent, cette concession est utilisée pour mieux asséner un argument contraire.
Initialement utilisé pour introduire un exemple ou une comparaison, « genre » est devenu un tic de langage pour adolescents surtout. « Ça te dirait de visiter des parcs d’attractions genre Disneyland Paris ou le Parc Astérix ? ». Dans un contexte informel, il peut remplacer « comme » ou « par exemple », à préférer.
Comment parler sans tics de langage ?
Plusieurs astuces permettent de contourner les tics de langage qui nous desservent. La préparation et l’entrainement favorisent l’aisance à l’oral et permettent de se connaitre mieux. Et savoir adapter son rythme à ses capacités d’élocution contribue à prendre confiance en soi devant un public.
L’entrainement, la meilleure solution pour prendre la parole avec assurance
Agathe Tupula Kabola, citée précédemment, nous donne quelques astuces pour diminuer la fréquence des tics de langages :
- S’enregistrer pour en prendre conscience.
- Arrêter les « euh » en les comptant.
- Associer les mots béquilles à des gestes.
- Faire des pauses intentionnelles lorsqu’un son inutile et parasite pointe le bout de son nez.
Le plus important est le temps consacré à l’entrainement et à la répétition du discours plusieurs jours avant l’intervention. Cela permet :
- d’être plus à l’aise avec les silences et de les placer plus naturellement ;
- de repérer ses tics de langage, d’en dresser une liste avec des synonymes et expressions similaires qui pourront les remplacer.
Si, par exemple vous utilisez trop souvent l’expression « du coup », vous pourrez la remplacer par les termes suivants : « par conséquent », « il en résulte que », « ainsi », « de fait », etc.
L’organisation, le maitre-mot pour éviter les tics de langage
Organisez et préparez votre discours est un gage de réussite. Il s’agit d’abord de travailler votre attaque, c’est-à-dire les premiers mots prononcés. Elle donne le ton de l’intervention.
Aussi, la tendance, lorsqu’on prend la parole d’un pas mal assuré, est de minimiser d’emblée les propos qui vont être tenus, au moyen de tics de langage. Par exemple, en disant : « Je vais vous parler un petit peu de… » Pourquoi « un petit peu » ? Mieux vaut assumer votre propos, et vous engager : « Aujourd’hui, j’ai envie de vous parler de…, parce que ce sujet me plaît, me tient à cœur. »
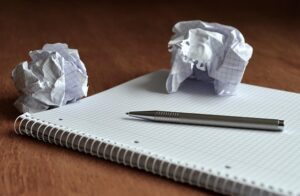
« Les tics de langages des éléments sont loin d’être vides, dans la mesure où ils aident la structuration et l’interprétation du discours. Mais c’est leur fréquence élevée qui leur donne un statut de tic ». Jérôme Jacquin
L’annonce du plan est un classique éprouvé durant notre scolarité. Il a l’avantage d’annoncer la couleur, de « préparer » l’auditoire. Pour le corps du texte, les phrases courtes ont plus d’impact. L’auditoire sera plus attentif si le discours est concis et l’argumentation claire. Enfin, la position, la tenue, la maitrise des outils numériques, la respiration, l’hydratation sont les recommandations à appliquer pour réussir un discours.
L’adaptation de la vitesse d’élocution à son propre rythme
Agathe Tupula Kabola précise que ralentir la vitesse d’élocution et parler plus fort font partie des stratégies pour diminuer la fréquence des tics de langage, notamment en ralentissant notre débit. Ainsi, les idées se clarifient et viennent à soi de façon plus fluide.
Prendre la parole devant un public n’est pas chose aisée. Trop souvent, prime la tendance à parler vite pour en finir rapidement avec la pression d’être face à des personnes qui nous écoutent parler. Les tics de langage viennent alors se glisser dans les propos.
Il existe de nombreuses méthodes pour se sentir mieux et en confiance lors d’un discours. La préparation psychique et matérielle est une étape essentielle pour oser prendre la parole en public. Ainsi, lorsque vous vous lancez à l’assaut de votre discours, respirez et parlez plus lentement. Pensez à sourire pour mettre de la joie et de l’intensité dans votre voix. Regardez vos interlocuteurs de façon naturelle en balayant l’assemblée des yeux, lentement. Imposez-vous des silences qui vous permettront de reprendre votre respiration et d’amorcer la suite de votre discours. Les tics de langage disparaissent alors en grande partie, car le besoin de « meubler » votre discours n’est plus ressenti.
Les tics de langage sont fréquents et universels. Ils ne nuisent pas forcément à la clarté du message, mais peuvent perturber les auditeurs. S’entrainer régulièrement, ralentir son débit, parler plus fort et faire des pauses, font partie des stratégies pour diminuer leur fréquence au cours d’une prestation orale. La rédaction préalable à une intervention est capitale. Découvrez ainsi comment améliorer votre expression écrite, en 3 étapes pour atteindre vos objectifs.
Sources :
Dictionnaire Le Robert
Wikipédia
Vitrine linguistique
Le Temps
Projet Voltaire
Radio Canada
Foudre d’éloquence
Japan Experience
CIA France
Wiktionnaire
Article rédigé par Anne AMERICH en collaboration avec Pleine Plume.